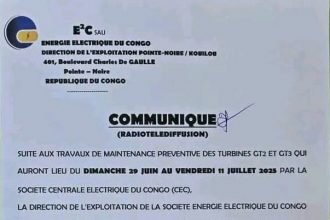Cent journalistes venus d’environ 90 pays participent à une formation chinoise. Présentée comme une opportunité internationale, cette initiative cache en réalité une stratégie ciblée : façonner l’image médiatique des pays pauvres et vulnérables à travers des journalistes modelés à la manière chinoise.
Une coopération asymétrique
Officiellement, il s’agit d’un échange de savoir-faire journalistique. En réalité, la Chine concentre ses efforts sur des nations fragiles, souvent marquées par la pauvreté, des institutions faibles et des médias déjà précarisés. Ce choix n’est pas innocent : il est plus facile d’y implanter un modèle médiatique aligné sur les intérêts de Pékin, en réduisant la marge de liberté des journalistes.
La presse comme outil d’influence
Peut-on sérieusement croire qu’un État qui contrôle chaque ligne publiée sur son territoire transmettra à ses « partenaires » africains et asiatiques les valeurs d’un journalisme libre et critique ?
Cette formation ne vise pas à enseigner l’impartialité, mais à inculquer une manière d’écrire, de penser et de diffuser l’information qui servira avant tout la stratégie internationale de la Chine.
Une colonisation idéologique
Ce n’est pas une aide, c’est une forme moderne de colonisation. En façonnant des générations entières de journalistes des pays pauvres, Pékin construit un réseau mondial de relais médiatiques capables de diffuser son récit, de défendre son modèle et de neutraliser les critiques. Pour le Congo-Brazzaville, cela signifie céder son troisième pouvoir — la presse — à une puissance étrangère qui ne croit pas à la liberté d’informer.
Quand l’État congolais abdique
Au lieu de bâtir ses propres écoles de journalisme solides, capables de former une élite indépendante, le Congo s’en remet à une puissance étrangère. Ce choix illustre un profond renoncement intellectuel : la raréfaction de l’esprit critique, remplacé par un mimétisme qui enferme le pays dans la dépendance.