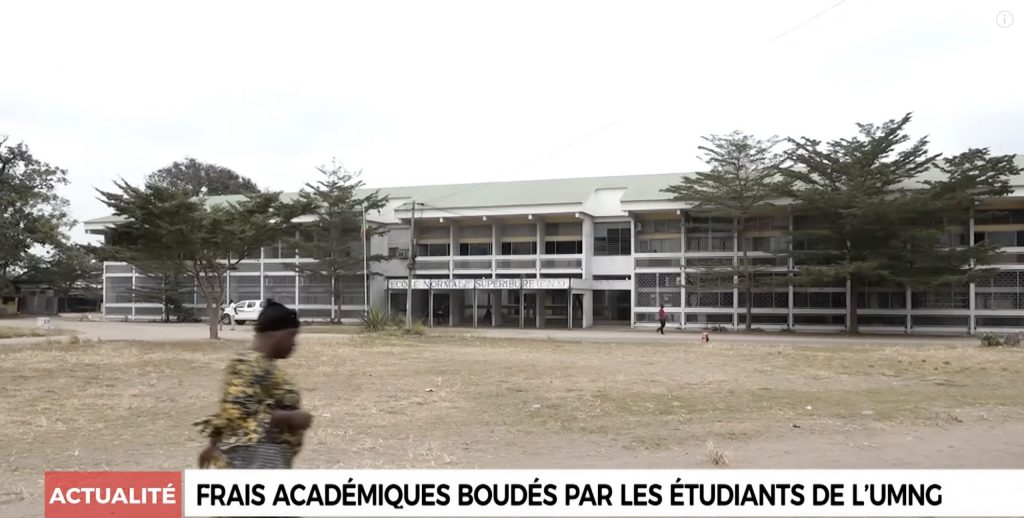L’annonce est tombée comme un couperet : pour l’année académique 2025-2026, les frais d’inscription à l’Université Marien Ngouabi (UMNG) grimpent en flèche. Les étudiants devront désormais débourser 21 000 francs CFA pour la licence, 50 000 francs CFA pour le master et 100 000 francs CFA pour le doctorat.
Une augmentation spectaculaire, officiellement présentée comme une « rationalisation des coûts » face au désengagement de l’État. Mais derrière cette justification technocratique, la colère gronde. Car au Congo-Brazzaville, il ne s’agit pas seulement d’une hausse des frais universitaires : c’est l’illustration d’un État absent, défaillant et indifférent au sort de sa jeunesse.
Une université délabrée, un pays à genoux
Comment demander aux familles, déjà écrasées par la pauvreté, de payer plus pour inscrire leurs enfants dans une université où les infrastructures s’effondrent, où les amphithéâtres sont surpeuplés, où les laboratoires manquent de matériel, et où les bibliothèques sont obsolètes ?
Pendant ce temps, les enseignants, souvent mal rémunérés ou en attente de salaires, continuent de se battre pour maintenir un semblant de dignité académique.
L’argent pour les « bourses fictives » existe
Le plus révoltant, selon de nombreux étudiants, c’est la contradiction flagrante entre cette hausse et la gestion opaque des finances publiques. On trouve des milliards pour financer des bourses fictives, alimenter des réseaux de corruption ou entretenir un train de vie somptueux de la classe dirigeante, mais on n’investit pas dans l’avenir de la jeunesse. « On nous demande des sacrifices alors que l’État dilapide l’argent public. C’est une insulte ! », fulmine un étudiant en master.
Quand l’anormal devient normal
Plus inquiétant encore, une partie de l’opinion, habituée à vivre dans l’anormalité, accepte cette situation comme « normale ». Comme si dans un pays où tout va à vau-l’eau — salaires impayés, hôpitaux délabrés, écoles en ruine — il fallait s’habituer à payer davantage pour recevoir moins. Cette résignation collective fait le jeu d’un pouvoir qui profite du silence et de l’impuissance des citoyens.
Un avenir hypothéqué
En réalité, cette décision n’est pas seulement une mesure financière : elle envoie un message clair. Dans ce Congo où l’argent disparaît dans les poches d’une élite prédatrice, l’éducation n’est plus une priorité.
La jeunesse, pourtant moteur du développement, est abandonnée à elle-même. Et dans ces conditions, comment imaginer un avenir meilleur pour le pays ?